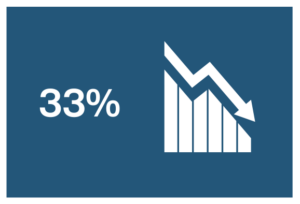
C’est la proportion de cliniques privées MCO déficitaires en 2023 (+8 points par rapport à 2022) selon la DREES.
![]()
Finance : + 362 millions / – 2,4 milliards d’euros
En 2023, la situation financière des hôpitaux publics se dégrade à nouveau très fortement avec un déficit de 2,4 milliards d’euros, alors que celle des cliniques privées affiche un résultat net positif de 362 millions d’euros.
En 2023, le résultat net des cliniques privées s’établit à 362 millions d’euros, soit 1,8 % de leurs recettes, en recul par rapport à 2022 (3,4 %). La proportion de cliniques privées déficitaires augmente (32 % en 2023, après 25 % en 2022). La proportion de cliniques déficitaires atteint 37 % en moyen séjour (+8 points), 33 % en court séjour (+8 points) et 18 % en psychiatrie (+1 point).
L’effort d’investissement des cliniques privées se replierait en 2023 (à 4,9 % des recettes en 2023, après 5,6 % en 2022). La proportion de cliniques privées surendettées diminue et atteint 14 % en 2023, son plus bas niveau historique.
La DREES explique cette très nette détérioration par la sortie progressive des dispositifs exceptionnels de soutien pour faire face à la crise sanitaire, dans un contexte inflationniste. Rapporté aux recettes, le résultat net est négatif, à hauteur de -2,3 % (après -1,3 % en 2022), une proportion inédite depuis 2005.
La DREES rappelle que les 122,1 milliards d’euros de dépenses en 2023 sont financés à 92,6 % par l’Assurance maladie. Le secteur hospitalier représente près de la moitié (49,1 %) de la consommation de soins et de biens médicaux et 6,3 % de la consommation finale effective des ménages.
![]()
4 naissances sur 5 dans les types 2 et 3
La DREES recense 457 maternités en 2023 (464 en 2022) : 163 de type 1, et 294 de type 2a, 2b ou 3. Elles ont réalisé 664 000 accouchements (48 800 de moins qu’en 2022). Les maternités de type 2 et 3 concentrent 78 % des lits, 83 % des accouchements.
La taille des maternités augmente avec le type de spécialisation : en 2023, le nombre d’accouchements par maternité s’élève à 682 pour les maternités de type 1, à 1 314 pour les maternités de type 2a, à 1 856 pour les maternités de type 2b, et à 3 088 pour les maternités de type 3.
En 2023, 5 % des maternités de France métropolitaine prennent en charge moins de 300 accouchements dans l’année, une proportion en légère progression sur une décennie (elle était de 3 % en 2013). Ces maternités se situent majoritairement dans des départements montagneux (Hautes-Alpes, Savoie, Corse) ou ruraux (Ardèche, Ariège, Aveyron, Cantal, Corrèze, Dordogne).
![]()
Mortalité infantile : analyse de 328 EIGS
La HAS formule dix préconisations pour réduire les événements indésirables graves associés aux soins (EIGS). Les déclarants ont jugé que 57 % des EIGS étaient majoritairement évitables ou probablement évitables.
Sur les 328 EIGS, la HAS a montré que les conséquences principales des EIGS ont été le décès dans 54 % des déclarations, une mise en jeu du pronostic vital dans 31 % des déclarations et un probable déficit fonctionnel permanent dans 15 % des déclarations. Parmi les 179 EIGS ayant entraîné un décès, 42 déclarations concernaient des enfants mort-nés (8 cas de mort fœtale in utero et 34 cas d’enfants nés vivants avec échec de la réanimation).
Les causes immédiates de ces EIGS les plus déclarées sont les erreurs en lien avec la prise en charge obstétricale, les erreurs liées aux soins ou à l’organisation des soins, et les erreurs médicamenteuses.
Quant aux causes profondes, il s’agit principalement de facteurs liés aux patients (notamment l’état de santé du nouveau-né et de la mère) ; aux tâches à accomplir (protocole incomplet voire absent, ou encore méconnu des professionnels impliqués dans la prise en charge) ; ou à l’équipe (défaut de communication, difficultés liées aux transmissions et alertes).
![]()
Mieux dépister le cancer du sein
La Société d’imagerie de la femme (Sifem) et la Société française de sénologie et de pathologie mammaire (SFSPM) préconisent des évolutions du dépistage organisé du cancer du sein en France et de relever le taux insuffisant à 60 %.
![]()
L’état de santé des 15 à 24 ans
La DREES publie les chiffres français d’une enquête européenne de 2019. Avant la crise sanitaire, plus de 9 sur 10 des 15-24 ans se perçoivent en « bonne ou très bonne santé » et 17 % déclarent avoir un problème de santé chronique.
Les principales pathologies chroniques citées sont l’allergie (41%, hors asthme) et l’asthme (26 %). Par ailleurs, 1 sur 5 présente une surcharge pondérale. Si la grande majorité des jeunes ont une corpulence normale, 14 % des 15-24 ans sont en surpoids (obésité non incluse), 5 % en obésité et 7 % en insuffisance pondérale.
7 jeunes sur 10 (68 %) déclarent avoir consommé des boissons alcoolisées au cours des douze derniers mois.
L’usage quotidien du tabac est en hausse chez les jeunes entre 15 et 24 ans : 1 sur 4 fume du tabac, 17 % quotidiennement et 9 % occasionnellement.
![]()
Crédits photos : Istock.





